Pavel Durov, philosophie et dissonances
Cet entretien de Pavel Durov par Lex Fridman #482 et qui dure plus de 4 heures est riche d’informations le concernant. Il y dévoile un peu de son histoire, de sa personnalité, ses valeurs et sa vision de la vie et du monde. J’ai eu envie d’analyser cette longue interview pour en ressortir la justesse de ses propos mais aussi les dissonances.
Il parle de son père, professeur, qui a beaucoup écrit sur la Rome antique et la littérature romaine, de sa mère, une femme intelligente et éduquée, de son enfance vécue dans la pauvreté, de ses études et ses changements d’établissements scolaires car il n’était pas un élève soumis et questionnait un peu trop les professeurs. Il intégra un collège expérimental à Saint-Petersbourg et parle de l’importance de l’éducation des mathématiques et des langues étrangères, matières qui permettent de comprendre ensuite la plupart des autres disciplines. Il parle de son frère, enfant prodige, programmeur, mathématicien et cryptographe duquel il a beaucoup appris et qu’il a sollicité à plusieurs reprises dans le développement de ses projets. Il loue ses qualités et décrit son frère comme une personne modeste, inspirante et qui a soif d’informations. « Les personnes intelligentes n’ont pas besoin de se montrer ou se vanter, elles sont gentilles et compatissantes », dit-il.
« Les mathématiques apprennent à s’exprimer clairement, oralement et par écrit et développent la mémoire. […] Elles sont les seules à faire travailler certains « muscles » du cerveau. […] les exercices les plus élémentaires, qui parfaitement compris et assimilés sont un tremplin pour les facultés et les possibilités de l’esprit les plus hautes » Arnaud-Aaron Upinsky, 2+2=5. De nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, page 235.
Il raconte les demandes qui lui ont été faites par les gouvernements et plus spécifiquement le gouvernement français pour « agir » lors des élections en Roumanie et en Moldavie. Il décrit comment notre gouvernement procède à des arrestations ou des contrôles fiscaux sans fin qui sont de véritables harcèlements dont le but est d’obtenir de la personne ce à quoi elle ne veut pas consentir (vendre sa société, accepter une ingérence des services de renseignements, etc.). Les agissements dont il témoigne sont ceux d’un appareil totalitaire qui utilise tous les organes de notre système dit démocratique afin de contrôler les individus, les opinions, les médias, les entreprises, etc..
Il revient à plusieurs reprises dans cet échange sur l’élaboration, le fonctionnement, les évolutions de son réseau : Telegram, utilisé à ce jour par un milliard de personnes dans le monde. Il en est le seul actionnaire et indique qu’après avoir investi beaucoup de capitaux, ce réseau n’est rentable que depuis 2024 grâce à l’abonnement Premium qui compte 15 millions d’abonnés depuis 2022 et rapporte 250 000 000 dollars par an. Contrairement aux autres réseaux sociaux, Telegram ne vend pas les données des utilisateurs ni ne les utilise pour de la publicité ciblée. J’y vois ici un rappel de ce que nous savons tous de façon plus ou moins consciente mais que nous oublions quand il s’agit de prendre conscience du pouvoir que nous avons de délaisser ces réseaux vampires et manipulateurs, que nous nourrissons et qui vident puis modèlent nos cerveaux. Nous nous heurtons ici à une des plus grandes difficultés de l’homme : changer ses habitudes ! Nous restons sur ces réseaux vampires par conformisme, parce que nombreux sont ceux qui y sont alors que nous pourrions, au moins, essayer de basculer ne serait-ce que progressivement vers des réseaux moins toxiques.
Pavel Durov partage un peu de son quotidien et sa vie que l’on pourrait qualifier d’ascète. Ne pas consommer de drogues comme l’alcool, le tabac ou autres produits illicites, ne pas céder aux plaisirs immédiats et privilégier l’effort, le travail, la patience, la persévérance, le sport, l’alimentation saine, le sommeil, etc.. Il affectionne ces heures au réveil où son esprit est fertile et pendant lesquelles les idées fusent et s’élaborent si on le lui permet. Il souligne qu’il s’abstient de toute lecture ou écoute pour rester totalement disponible à lui-même. Il est vrai que nombreux d’entre nous consultent les réseaux sociaux, le journal ou écoutent la radio au réveil, ce qui interfère donc avec nos propres pensées qui disparaissent dans ce « bruit ».
« Appendice : la « laisse acoustique ».
Jusqu’à maintenant, dans notre exposé du « dépouillement de notre liberté acoustique », nous nous sommes contentés de montrer que, dans la mesure où nous sommes écoutés, nous ne sommes plus nos propres maîtres mais devenons un bien public. En disant cela, nous n’avons décrit qu’une moitié du « dépouillement de notre liberté acoustique ». Car ce dont nous sommes dépouillés n’est pas seulement notre liberté de vivre sans être écoutés, mais aussi notre liberté de vivre sans écouter. Que vise-t-on ici ?
Pas seulement le fait ordinaire d’être forcé de vivre dans un monde chaque jour plus bruyant. Pas seulement le fait que nous devions écouter. Mais – c’est pire et c’est en même temps plus humiliant – le fait que ce devoir ait valeur de contrainte qu’on exige de nous que nous écoutions. Formulé dans l’autre sens : on vise le fait que le bruit n’est pas seulement un scandale mais qu’il a une fonction, une tâche – celle de garantir notre participation au processus de notre propre dé-privatisation – , qu’il constitue l’un des instruments principaux du conformisme. »
Günther Anders - L’obsolescence de l’homme, Tome II, page 238-239.
En fin d’interview, il parle du dilemme des deux chaises (le choix de Sophie) et ses explications sur les manipulations « Nous sommes très souvent manipulés par les politiciens, par les chefs d’entreprises à devoir faire un choix entre deux solutions imparfaites… et forcés à faire ce choix, c’était comme si c’était à nous d’en assumer la responsabilité ». Cette prise de conscience, aujourd’hui, paraît cruciale, vitale.
Pour finir, la vision de l’IA qu’il partage avec son père : elle ne pourra jamais avoir de conscience, de principes profonds, d’intégrité ou être morale et par conséquent, elle ne saura jamais faire la différence entre le bien et le mal.
Les dissonances des propos de Pavel Durov :
1/ Pavel Durov loue Telegram comme un outil de liberté d’expression, qu’il façonne en terme de design, d’esthétique pour, dit-il, apporter du plaisir à son utilisateur mais, il n’en est pas lui-même utilisateur et se préserve de toute influence de ces réseaux. Il se contredit donc notamment avec cette exemplarité qu’il prône notamment quand il parle du fait que les enfants imitent les actes de leurs parents bien plus qu’ils n’agissent en fonction de ce que leurs parents leur disent ce qu’il est convenable de faire.
2/ Il explique qu’il se méfie de tout média en se demandant ce qu’il « vend » avec l’article qu’il propose tandis qu’il vante les mérites de Telegram qui se trouve être totalement libre, indépendant et dans le respect total de la confidentialité des échanges de ses utilisateurs.
3/ Il admire la mise en compétition qu’il juge le moteur principal au dépassement de soi alors même qu’il indique que son frère en est exempt et qu’il a une soif de savoir qui l’a amené au plus haut niveau. Cependant la compétition n’amène-t-elle pas la rivalité de laquelle découlent des comportements agressifs, toxiques, voire meurtriers, comme en l’explique René Girard dans la théorie mimétique, selon laquelle « tout désir est l’imitation du désir d’un autre ». Ce désir d’être mieux que l’autre plutôt que de se centrer sur soi pour mieux développer sa singularité.
Pascal Corradini, enseignant depuis 30 ans, que nous avons interviewé à plusieurs reprises (voir l’école des possibles) a volontiers répondu à notre demande et nous offre quelques pistes de réflexions que nous avons publiées dans nos Tribunes et dont nous avons extrait ce qui suit :
Compétition versus coopération
La quasi-totalité de l’humanité fonctionne aujourd’hui suivant le modèle occidental, basé sur la compétition. Notre économie tout particulièrement, est caractérisée par une concurrence permanente et de plus en plus agressive. Aussi, parle-t-on de guerre économique pour laquelle c’est « la loi du plus fort » qui s’applique !
Toutefois, la coopération est également présente dans nos sociétés. Le fonctionnement en associations, très répandu en France, en est une illustration, tout comme la création de la sécurité sociale...
Animaux-humains que nous sommes, serions-nous destinés à nous faire perpétuellement la guerre, sous des formes diverses et variées ?
Pourtant, durant son enfance, l’être humain est fondamentalement coopératif. Dans de nombreuses situations, j’ai pu observer, que suite à la peur instinctive que peut avoir l’enfant (de perdre son jouet par exemple, et le mettant en compétition avec d’autres), grâce à un accompagnement adapté de l’adulte, cette peur peut assez rapidement disparaître et laisser place à un comportement pacifique, puis coopératif. Un comportement de relation chaleureuse avec l’autre, une dimension féminine de dialogue avec l’autre, d’accueil dans sa différence, avec une place pour l’expression de ses sentiments, une place pour ce qui est sensible en nous...
La compétition comme unique façon de déployer ses talents ? Ce sont les enfants qui nous démontrent le contraire. Ils sont caractérisés par des élans d'apprentissage qui sont observables lorsque les enfants se sentent en sécurité, au sein d'une famille, ou/et équipe éducative de soutien. En somme, lorsque un climat de coopération règne dans un groupe... Aussi, ces élans d'apprentissage, qui sont des élans de vie, se transforment en élans créatifs, donnant envie à l'enfant, puis à l'adulte qu’il deviendra, de faire toute chose en vue de son épanouissement, de son déploiement…
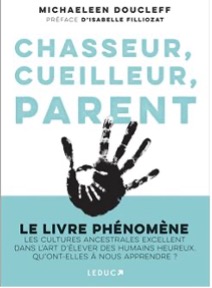
J’ai découvert le livre « Chasseur cueilleur parent » qui montre bien cela, au travers de l’application par Michaeleen Doucleff (maman de Rosy, 3 ans) des méthodes éducatives familiales dans trois des plus vénérables communautés du monde : les Mayas au Mexique, les Inuits au-dessus du cercle arctique et les Hadzas en Tanzanie.
La coopération serait-elle donc une faculté naturelle que nous avons en nous, enfant, puis que nous perdons adulte ?
Il me semble plutôt que cela dépende de la société dans laquelle l’être humain évolue. En effet, durant une première partie de sa vie, l’être humain est conditionné par le corps social de sa société, il est en quelque sorte « engrammé ».
Ainsi, nous pouvons observer que des peuples Mayas, Inuits, Hadzas et bien d’autres comme les Kogis, que vous pourrez découvrir ci-dessous, cultivent et vivent la coopération au sein de leur communauté, et avec les communautés voisines. Cette valeur fondamentale est par conséquent à la base de l’éducation de leurs enfants. La boucle est bouclée, de fait, cela favorisera la perpétuation de la coopération au sein de leur société.
Dans un groupe humain où la coopération est cultivée, chaque membre du groupe aspire à déployer ses talents en vue de contribuer au groupe, non pas pour devenir le vainqueur, mais plutôt pour nourrir le besoin essentiel de contribution propre à l'être humain, ainsi que le besoin de respecter son prochain, et plus largement de respecter le vivant, la nature... et avec des talents de chacun, chacune qui sont complémentaires, comme dans la nature...
Pavel Durov ne semble pas considérer les difficultés/dysfonctionnements que nos sociétés ont rencontrées au cours de l'histoire, en raison de la compétition (guerres notamment), ni ce qu'elles ont causées comme dommages (faim dans le monde, climatiques, mal-être, stress, maladies...), et ce que cela augure, à savoir « les murs » que nous risquons forts de rencontrer à court et moyen terme...
La compétition est comme le ver dans le fruit, et l'idée n'est pas de tuer le ver dans le fruit, mais plutôt de l'éloigner pour favoriser toute l'expression de la coopération. La perpétuation de la compétition au sein de nos sociétés n’est pas inéluctable. Avec la conscience montante au sein de la population, que la compétition pourrait occasionner la disparition de l’espèce humaine, espérons que des changements significatifs adviendront !
Pour cela, les lois de la nature, les lois de préservation de la vie que l’homme se doit de respecter, devront remplacer les « lois du plus fort », de compétition économique, faites par l’homme pour l’homme. Pour opérer ce changement, sans doute pourrions-nous nous inspirer de ces vénérables communautés du monde, au sein desquelles la dimension féminine est très présente, et expérimenter des solutions en faisant preuve d’humilité, de sensibilité, de créativité... à l'image des connaissances ancestrales des Kogis, dont je suis passionné.
Pascal Corradini – 14 octobre 2025
4/ Il dit avoir tout appris de son frère dont il loue les qualités humaines ainsi que celles des personnes intelligentes (voir supra) mais lorsqu’il parle de ses collaborateurs, son exigence est extrême : « l’insatisfaction de travailler avec des personnes qui ont une capacité mentale et intellectuelle qui n’est pas au niveau, qui n’ont pas le talent naturel et une incapacité à se concentrer pendant une longue période… c’est une insulte de travailler aux côtés de quelqu’un de distrait et incapable ». Bien sûr, on peut comprendre qu’il souhaite développer ce qu’il y a de mieux cependant, ses jugements tranchés et sévères semblent dénués du regard plus philosophique et humaniste, dont il fait preuve par ailleurs en louant la compassion, la tolérance et la richesse de l’humanité. Ses collaborateurs semblent être jugés comme des instruments qu’il utilise à ses propres fins.
« La fin justifie les moyens : Quand un homme est dans une situation de responsabilité, il est toujours forcé de choisir entre deux possibilités : ou bien il subordonne les Moyens à la Fin, ou l’inverse. […] Si l’on a choisi de subordonner les Moyens à la Fin, la pente vous fait glisser toujours plus bas sur le tapis roulant de la logique utilitaire. […] Le mécanisme était déjà connu de Pascal : "L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête."» Ariane Bilheran, Psychopathologie du totalitarisme, page 214.
5/ Il a sollicité son frère pour l’aider dans la réalisation de ses projets à maintes reprises. Il reconnaît que son père lui a donné l’exemple de la valeur travail mais ne l’évoque pas plus dans ce qu’il lui aurait transmis et notamment dans la relation affective père-fils tandis qu’il confirme ne jamais vouloir le décevoir. Cette distance est notable lorsqu’il parle de sa propre paternité qui semble également distante, calculée, dénuée d’affectif voire même purement biologique quand il parle de ses nombreux enfants conçus par don de sperme.
6/ Sa discipline de vie, louable en théorie, le contrôle total qu’il affiche, ne révèlent-t-ils pas une vision parcellaire de la vie en excluant les émotions, les sentiments, les enfants et tous ces aléas qui font de nous des êtres perfectibles mais assurément humains ? La recherche de la perfection ne peut-elle pas confinée parfois à une recherche prométhéenne ? L’image du père ne serait-elle pas idéalisée ?
7/ L’expérience de John B. Caloun dont il parle concernant des souris élevées dans l’opulence et dans un univers restreint est à pondérer et ne saurait, à mon sens, justifier l’inégalité dans la répartition des richesses et encore moins valider les théories de « surpopulation » justifiant la dépopulation :
« La tentation anthropomorphique est presque irrésistible… Mais l’être humain n’est pas, et ne sera jamais, une souris. En situation de promiscuité, il sait gérer. En 1975, déjà, le psychologue Jonathan Freedman avait organisé une expérience similaire avec des étudiants… Sans observer le moindre effet négatif. En 2008, l’historien médical Edmund Ramsen offrait une analyse bien plus nuancée des résultats de Calhoun, expliquant que tous les rats n’étaient pas devenus dingues. La clé, selon lui, réside dans la gestion de l’espace individuel : ce qui rend fou, ce sont les interactions sociales subies en permanence. L’enfer, c’est parfois donc bien les autres, mais c’est aussi et surtout l’inégalité de distribution des ressources. Qu’on soit un rat de laboratoire ou un esclave du capitalisme. » Source : Vice.com Des utopies pour souris ont prédit l’effondrement de notre société.
Il m'a semblé utile d'analyser l'interview de cette personnalité de la façon la plus objective possible, non pour le critiquer ou l'encenser mais bien pour donner un exemple du discernement qu'il convient à chacun de préserver.
Cet article est :
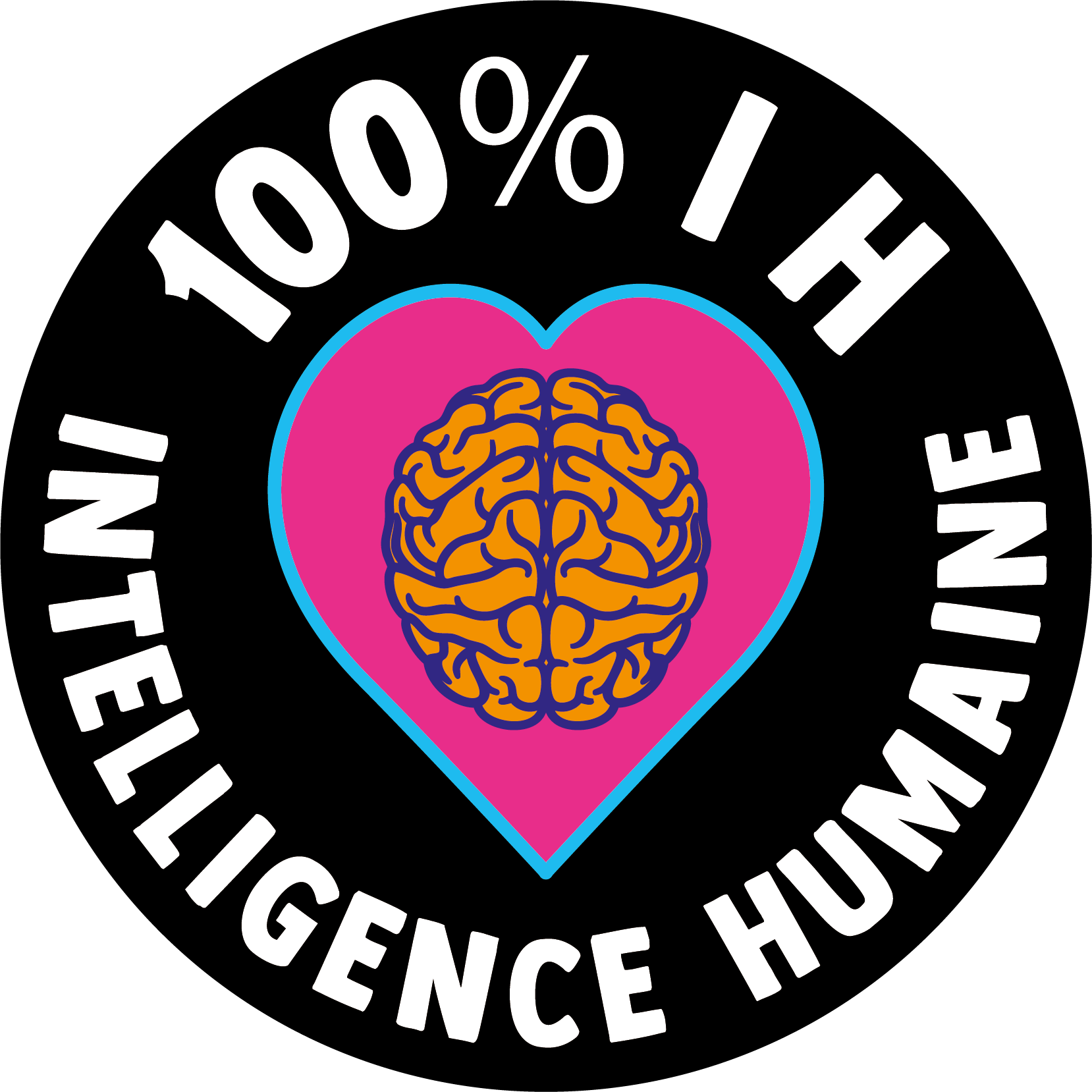
Dépêches Citoyennes
Recevez nos articles automatiquement
Tous droits réservés (R) 2023-2024

